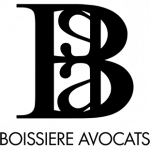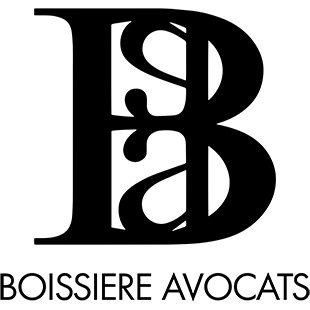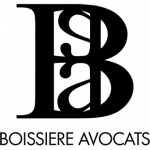Alcool au volant
LA CONDUITE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE
Vous avez fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie positif au volant d’un véhicule terrestre à moteur. Hors accident de la circulation, ce contrôle aura été réalisé dans l’air expiré au moyen d’appareils de précision :
Vous avez d’abord été soumis à un dépistage préalable au moyen d’un éthylotest chimique ou électronique qui, positif, va entraîner une vérification précise du taux d’alcoolémie par litre d’air expiré au moyen d’un éthylomètre.
C’est en fonction du taux retenu – après pondération par une marge légale d’erreur – que l’infraction sera ou non qualifiée :
Entre 0,25mg/litres d’air expiré et 0,39mg/litres d’air expiré (soit 0,50 à 0,79 grammes d’alcool par litre de sang): il s’agit d’une contravention de 4ème classe, pour laquelle vous serez verbalisé par avis de contravention forfaitaire à 135€ d’amende et entraînant un retrait de 6 points sur votre permis de conduire. Votre permis de ne sera donc pas retenu sur le champ et ne fera pas l’objet d’une suspension administrative. Dans ce cas de figure, pour éviter la perte de 6 points et l’annulation de votre permis de conduire, reportez à la rubrique contestation avis de contravention du présent site.
Attention : pour les jeunes conducteurs (moins de 3 ans de permis de conduire), les minima légaux diffèrent. L’infraction est constituée à partir de 0,10 mg/litres d’air expiré (soit 0,20 grammes d’alcool par litre de sang).
Au-delà de 0,40mg/litres d’air expiré (soit 0,80 grammes d’alcool par litre de sang): il s’agit d’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (“CEEA” ou “CEA”) qui va entraîner des poursuites à votre encontre par le Procureur de la République. Votre permis de conduire fera l’objet d’une rétention immédiate vous ôtant immédiatement le droit de conduire. Vous serez alors poursuivi judiciairement et encourrez, devant une juridiction répressive :
- 2 ans d’emprisonnement délictuel
- 4500€ d’amende
- 3 ans de suspension de votre permis de conduire ou l’annulation de votre permis de conduire avec interdiction d’obtenir dans un délai de 3 ans au plus
- l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti démarrage électronique pendant 5 ans au plus
- l’inscription au casier judiciaire et au Fichier National des Permis de Conduire
- diverses peines complémentaires comme le stage de sensibilisation à la sécurité routière
- un retrait de 6 points sur le permis de conduire
Attention : en cas de récidive légale, c’est à dire si vous avez déjà été condamné au cours des 5 années précédentes pour un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou une infraction assimilée par la loi, les sanctions légales sont automatiquement doublées et l’annulation du permis de conduire comme la confiscation du véhicule sont automatiques.
Dans ces cas, il vous est vivement conseillé de prendre attache avec un avocat spécialiste des délits routiers et notamment de l’alcool au volant.
LA CONDUITE EN ÉTAT D’IVRESSE
La conduite en état d’ivresse manifeste est sanctionnée légalement par les mêmes peines que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Ce délit pourra être relevé sans contrôle par éthylotest et ethylomètre si l’agent ou l’officier de police judiciaire établissent par des critères relevant d’un examen du comportement que vous conduisiez manifestement sous l’emprise de l’alcool.
LE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS ALCOOLIQUES
Ce délit est poursuivi si vous refusez de vous soumettre aux épreuves de dépistage. Il vous fait encourir légalement les mêmes peines que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique du simple fait d’avoir refusé de souffler ou d’avoir simulé l’impossibilité de souffler.
Vous pourrez donc être condamné sans mesure du moindre taux ni même de signes comportementaux caractéristiques de l’ivresse.
Il vous est donc vivement recommandé d’accepter le contrôle pour permettre à vos avocats spécialistes alcool au volant d’étudier la régularité de la procédure de vérification alcoolique.

Vous pouvez consulter les résultats du Cabinet notamment en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Nos avocats sont spécialistes des dossiers d’alcool au volant et conduite en état d’ivresse.