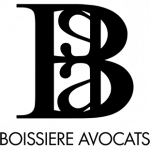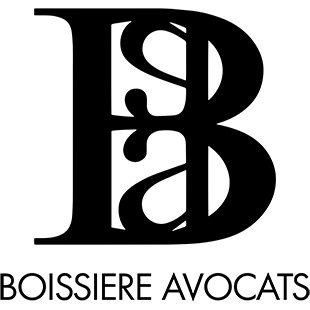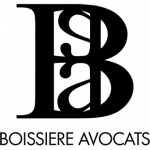Stupéfiants au volant
Le fait de conduire un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, opiacés…) expose l’automobiliste à des poursuites sévères s’agissant d’un des délits routiers les plus strictement sanctionnés par les tribunaux correctionnels.
Fort de 12 ans d’expertise professionnelle exclusivement dédiée au droit routier, le Cabinet de Maître BOISSIERE assure votre défense en matière de conduite sous stupéfiants grâce à une solide approche et analyse procédurale. Si le contrôle est irrégulier, aucune sanction ne pourrait vous être opposée.
LA CONDUITE EN AYANT FAIT USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS
Par le passé exclusivement réalisé par analyse sanguine ou urinaire, le contrôle des conducteurs sous stupéfiants a connu un bouleversement à partir de 2018.
Ce contrôle est aujourd’hui réalisé essentiellement par des tests salivaires, ce qui le rend aussi aisé à réaliser qu’un simple contrôle d’alcoolémie et expose notamment les consommateurs de cannabis à de lourdes sanctions, à toute heure du jour et de la nuit.
Surtout, et contrairement à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le délit de conduite sous stupéfiants ne suppose pas d’être sous influence du produit.
Aujourd’hui en France, le simple fait d’être positif est constitutif du délit. En la matière, la loi sanctionne donc le simple fait de retrouver des traces de stupéfiants dans l’organisme, sans se soucier de savoir si le conducteur était sous influence. Vous avez consommé du cannabis il y a plusieurs jours ? Vous exposez quand même votre responsabilité pénale.
LE CONTRÔLE DE STUPÉFIANTS
Lorsque le résultat du dépistage salivaire ou urinaire est positif, le conducteur devra se soumettre à un prélèvement salivaire réalisé au moyen d’un simple coton-tige pour recueillir la salive.
En cas de prélèvement salivaire, le conducteur pourra se réserver la possibilité de demander une contre-expertise qui sera dès lors réalisée par un prélèvement sanguin pour analyse ultérieure.
En cas d’analyse sanguine (ce qui est de plus en plus rare et intervient aujourd’hui presque exclusivement en cas d’accident de la route) le prélèvement sera légalement réalisé en 2 échantillons sanguins répartis dans deux tubes étiquetés et scellés envoyés dans un laboratoire de police scientifique (un pour analyse et un pour conservation en vue d’une éventuelle seconde analyse qui serait sollicitée par le conducteur).
Le refus de se soumettre aux épreuves de vérification stupéfiant est également un délit, puni des mêmes peines que si le dépistage et la vérification avaient été positif.
LES SANCTIONS APPLICABLES À LA CONDUITE APRÈS USAGE DE STUPÉFIANTS
La conduite après usage de stupéfiant est un délit. Sachez qu’en cas d’interception par les forces de l’ordre, la commission de cette infraction peut engendrer une rétention immédiate de votre permis de conduire pendant 120 heures, ainsi qu’une suspension administrative pouvant aller jusqu’à 6 mois. De plus, votre véhicule peut être immobilisé si vous n’êtes pas accompagné d’une personne détentrice du permis de conduire. Une saisie de votre véhicule avant l’audience est également possible.
LES SANCTIONS LÉGALES :
- 2 ans d’emprisonnement délictuel
- 4500€ d’amende délictuelle
- 3 ans de suspension ou annulation judiciaire du permis de conduire
- Travaux d’intérêt général
- Jours-amende
- Interdiction de conduire certains véhicules y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé
- Stage de sensibilisation à la sécurité routière
- Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
LA RÉCIDIVE DE CONDUITE EN AYANT FAIT USAGE DE STUPÉFIANTS :
La commission de ce délit en récidive légale (personne déjà condamnée définitivement pour des faits identiques ou assimilés au cours des 5 dernières années) entraîne des sanctions doublées et une annulation du permis de conduire + confiscation du véhicule obligatoires :
- 4 ans d’emprisonnement délictuel
- 9000€ d’amende délictuelle
- Annulation obligatoire du permis de conduire avec interdiction de le repasser jusqu’à 3 ans
- Confiscation obligatoire du véhicule si l’auteur en est le propriétaire (sauf décision spécialement motivée)
- Immobilisation du véhicule pendant une durée maximale d’un an
La dépendance aux produits stupéfiants n’est pas une fatalité, vous pouvez vous faire aider. Consulter le site du gouvernement www.drogues.gouv.fr.
Le Cabinet BOISSIERE Avocats ne cautionne en aucune mesure le fait de conduire en ayant fait usage de stupéfiants.

Consultez les résultats du Cabinet BOISSIERE Avocats notamment en matière de conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Que vous soyez poursuivi pour cannabis au volant, cocaïne ou opiacés nous mettons à votre disposition notre savoir faire spécialisé dans votre défense. Nos nombreuses relaxes et vices de procédure sont directement accessibles dans nos résultats.